Blog
La 3e conférence des Nations Unies sur l’Océan s’est tenue en France du 9 au 13 juin dernier. Les enjeux étaient nombreux : l’océan, véritable berceau de notre avenir, nécessite une mobilisation urgente des États pour assurer sa préservation. Que peut-on dire de cet événement ?
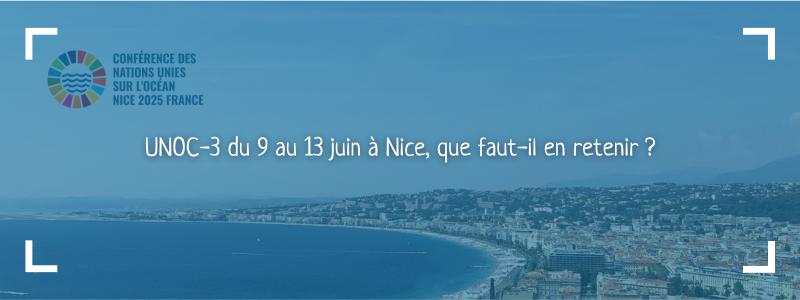
En 2025, la France célèbre « l’année de la mer » et se mobilise au travers de diverses initiatives pour mieux faire connaître les enjeux maritimes et inciter à la préservation de l’Océan. Et pour cause ! Du 9 au 13 juin dernier, Nice a accueilli la 3e conférence des Nations Unies sur l’Océan. Les attentes étaient élevées et le positionnement de la France dans cet événement, détentrice du 2e plus grand domaine maritime mondial, était au cœur du débat médiatique. Voyons ensemble quelles grandes décisions ont été prises lors de l’UNOC-3 mais tout d’abord, revenons sur les avancées obtenues lors des deux précédentes éditions.
Quel bilan pour les deux premières conférences sur l’Océan ?
La première Conférence des Nations Unies sur l’Océan s’est tenue à New York en juin 2017, coorganisée par les gouvernements de la Suède et des Fidji. Elle a marqué un tournant majeur dans la reconnaissance internationale des enjeux océaniques, avec l’adoption d’un « Appel à l’action » par les 193 États membres de l’ONU. Plus de 1 300 engagements volontaires ont été enregistrés, couvrant des domaines variés tels que la réduction de la pollution plastique, la création de zones marines protégées (ZMP) et la gestion durable des pêches.
La conférence de 2017 a été un moment clé pour sensibiliser à grande échelle aux enjeux océaniques. Cependant, avec ses financements limités et sans mise en oeuvre concrète, les attentes de ce premier sommet n’ont pas été satisfaites.


En 2022, la deuxième édition du sommet sur l’Océan a réuni 25 chefs d’états et de gouvernement et 6000 participants dont 2000 représentants de la société civile. Voici ce que l’on peut en retenir :
- Durant celle-ci, plus de 100 pays se sont engagés à protéger ou à conserver au moins 30 % de l’océan mondial d’ici 2030, en créant des aires marines protégées (AMP). Cet objectif s’inscrit dans le cadre de l’Agenda 2030 pour le développement durable et de la Convention sur la diversité biologique.
- Un comité intergouvernemental a été mis en place pour élaborer un traité international juridiquement contraignant visant à éliminer la pollution plastique.
- Des initiatives ont été lancées pour lutter contre la pêche illicite non déclarée et non réglementée (notamment par les États-Unis, le Canada et le Royaume-Uni).
- La France, la Colombie et le Costa Rica ont lancé une coalition internationale pour le carbone bleu, visant à protéger et restaurer les écosystèmes marins afin d’absorber le carbone et de lutter contre le changement climatique.
- La Banque de développement d’Amérique latine a annoncé un investissement de 1,2 milliard de dollars pour soutenir des projets océaniques dans la région.
- La Déclaration de Lisbonne s’engage à promouvoir la participation pleine et effective des femmes et des filles dans les activités liées aux océans.
Cependant, la Déclaration de Lisbonne reste un texte dépourvu d’actions de mise en œuvre. Elle se contente de réaffirmer des engagements volontaires sans imposer de mesures concrètes ou de sanctions en cas de non-respect. Les ONGs de lutte contre la pollution plastique déplorent l’absence de décisions concrètes face à ce fléau tandis que les discussions sur l’exploitation minières des fonds marins n’ont pas aboutie sur la création d’un moratoire interdisant la pratique.
Au regard des limites des deux premières conférences, la 3ᵉ conférence des Nations Unies sur l’Océan était particulièrement attendue pour initier des actions concrètes, financées et juridiquement contraignantes pour la préservation de l’Océan. Les attentes portaient également sur la mise en place de mécanismes de suivi clairs, un encadrement de l’exploitation des fonds marins et une véritable inclusion des communautés côtières.
Quel programme et quelles délégations étaient présentes à l’UNOC-3 ?
La 3ᵉ Conférence des Nations Unies sur l’Océan (UNOC-3) s’est donc tenue à Nice du 9 au 13 juin 2025, coorganisée par la France et le Costa Rica. Cet événement a réuni plus de 60 chefs d’État et plus de 100 membres de gouvernements, 20 000 délégués représentant les 193 États membres de l’ONU, des agences spécialisées, la société civile, le secteur privé et des donateurs internationaux.
La conférence s’est structurée autour de deux zones principales :
- La zone Bleue (9 au 13 juin) : réservée aux délégués accrédités qui a accueilli des sessions plénières avec des déclarations officielles des États membres, des Ocean Action Panels (OAP) et diverses prises de paroles.
- La zone Verte (28 mai au 15 juin) était quant à elle ouverte au public et était composée de 10 à 12 pavillons thématiques avec des expositions et des expériences immersives en réalité virtuelle pour informer et engager les citoyens dans la protection de l’Océan.
Durant cette conférence, la science a été placée au cœur des décisions. L’événement est également marqué par une forte mobilisation économique ainsi qu’une belle implication de la société civile.

Les victoires obtenues durant l’UNOC-3
Durant cette 3e édition, quelles ont été les principales avancées en matière de protection de l’Océan ?
- Le BBJN, Traité International sur la Haute mer qui doit veiller à la protection de la biodiversité au-delà des zones de juridiction des Etats, est ratifié par 50 Etats. Une vingtaine de pays ont ratifié le traité pendant la conférence, 5 ratifications sont en cours et 12 Etats se sont engagés à le ratifier d’ici septembre. Cette avancée permettrait d’atteindre les 60 signatures nécessaires à la mise en application du traité. Traité que l’on sait déterminant pour l’avenir de l’écosystème marin puisqu’il pourrait en résulter la création d’AMP dans ces espaces. Pour rappel, la Haute Mer représente plus de 70% de l’Océan !
- Sur le sujet de la pollution plastique, 96 pays se sont engagés en faveur d’un traité ambitieux pour réduire la production des matières plastiques. Les négociations sur le sujet reprendront au mois d’août 2025 à Genève lors de la cinquième session du Comité Intergouvernemental de négociation (INC-5) chargé d’élaborer le traité.
- Dans le secteur de la pêche, 103 Etats soit un total de 3 000 bateaux ont ratifié l’accord de l’Organisation Mondiale du Commerce contre les subventions des techniques de pêches destructrices. Pour faire entrer en vigueur cet accord, il faudra encore rassembler 600 bateaux.
- Plusieurs pays ont pris un positionnement fort concernant la mise en place et l’augmentation de leurs zones classées en AMP (Aires Marines Protégées). Désormais, 20% de la plus grande AMP au monde située en Polynésie française sera placée en protection stricte. D’ici fin 2026, non plus 0,1 mais 4% des eaux de l’Hexagone devraient être classées en protection forte. Sur les 30% nécessaires à l’échelle mondiale d’ici 2030, l’UNOC a permis de passer de 8,7 à 11%. Enfin, le chalutage de fond dans ces zones protégées est discuté mais ce n’est pas le cas des autres techniques de pêches pratiquées dans la colonne d’eau, qui entrainent beaucoup de capture accidentelle.
- Concernant l’exploitation minière des fonds marins, seuls nouveaux 5 pays ont adopté le moratoire l’interdisant pour un total désormais porté à 37 signataires. Cependant, une coalition financière de 63 banques et institutions s’est constituée et engagée à ne pas financer cette initiative.
Océan : les défis qui demeurent
Malgré de belles avancées en matière de protection de la biodiversité de la Haute Mer, d’encadrement de la pêche destructrice et de réduction de la pollution plastique, l’UNOC-3 n’aura pas su mobiliser pleinement sur la protection stricte des AMP et l’interdiction complète du chalutage de fond dans ces zones sensibles. L’importance de l’Océan dans la lutte contre le changement climatique et la surexploitation des énergies fossiles furent également peu discutées. La France était pourtant très attendue sur ces sujets.
L’UNOC-3 a toutefois marqué un tournant décisif dans la gouvernance mondiale des océans et permis de renforcer les coalitions internationales, notamment avec la création de la Coalition Ocean Rise & Coastal Resilience, visant à soutenir l’adaptation des villes et régions côtières face à l’élévation du niveau de la mer.
L’importance de la science dans la prise de décision a également été mise en avant, avec des engagements visant à intégrer les connaissances océaniques dans les politiques publiques. Ainsi, l’UNOC-3 a non seulement consolidé les alliances internationales, mais a également placé la science au cœur de l’action pour la préservation des océans et la durabilité de notre planète.
> Pour en savoir + sur la coalition Océan et les résultats de ces journées de coopération, je vous invite à consulter les sites de unocnice2025.org, ocean-climate.org, oceandecade.org ou encore oceanrise-coalition.org

